Cinq Semaines en ballon
| Cinq Semaines en ballon | ||||||||
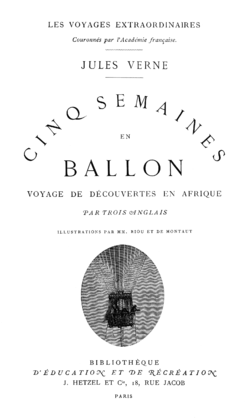
| ||||||||
| Auteur | Jules Verne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | France | |||||||
| Genre | Roman d'aventures | |||||||
| Éditeur | Pierre-Jules Hetzel | |||||||
| Collection | Les Voyages extraordinaires | |||||||
| Date de parution | 1863 | |||||||
| Illustrateur | Édouard Riou | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Cinq semaines en ballon est un roman de Jules Verne, paru en 1863.
Historique
Le roman est publié en édition in-18 le [1] et a pour sous-titre Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais. La grande édition in-8o est mise en vente le [2].
Il s'agit du premier roman de Verne édité par Pierre-Jules Hetzel après le refus du Voyage en Angleterre et en Écosse[3]. Verne y met au point les « ingrédients » de son œuvre à venir, mêlant avec habileté une intrigue féconde en aventures et en rebondissements de toutes sortes et des descriptions techniques, géographiques et historiques. Le livre fait un bon résumé des explorations du continent africain, à cette époque encore incomplètement connu des Européens mais sillonné par les explorateurs qui veulent en découvrir les secrets.
Résumé
Un savant et explorateur, le Dr Samuel Fergusson, accompagné de son serviteur Joe et son ami chasseur professionnel Richard "Dick" Kennedy, décident de survoler l'Afrique orientale, de Zanzibar aux sources du Nil - région alors pas complètement explorée - à bord d'un ballon gonflé à l'hydrogène, le "Victoria". Il a inventé un mécanisme qui, en éliminant la nécessité de libérer du gaz ou de jeter du lest pour contrôler son altitude, permet d'effectuer de très longs trajets en toute autonomie. Ce voyage est destiné à relier les régions explorées par Richard Burton et John Hanning Speke en Afrique de l'Est avec celles de Heinrich Barth dans les régions du Sahara et du Lac Tchad.
Le voyage commence à Zanzibar sur la côte de l'Océan Indien, et survolant le lac Victoria, le lac Tchad, Agadez, Tombouctou, Djenné et Ségou, aboutit à Saint-Louis, colonie française aujourd'hui appartenant au Sénégal, sur la côte de l'Océan Atlantique.
Le livre décrit les multiples et dangereuses aventures que vont vivre les trois hommes.
Personnages principaux

- Docteur Samuel Fergusson
Il est britannique. Il a des connaissances profondes sur les sciences naturelles et son imagination est très riche. C'est un voyageur, et dans le même temps il est explorateur.
- Joseph Wilson, aussi connu sous le simple nom de Joe
Il est au service du docteur Samuel Fergusson, intelligent ainsi que très dévoué.
- Richard "Dick" Kennedy
Il est chasseur et très courageux. Quand il a appris le projet téméraire du Docteur Samuel Fergusson, il a essayé de l'empêcher.
Genèse et publication du roman
Après avoir refusé le Voyage en Angleterre et en Écosse, Hetzel demanda à Verne d'écrire un vrai roman de voyage et non un récit[4]. Verne lui présente quelque temps plus tard son Voyage en l'air qu'Hetzel accueille avec enthousiasme.
Le roman est distribué par Hetzel mais aussi à Leipzig, en Allemagne[5]. Hetzel fait imprimer en 1863 deux tirages de 1000 exemplaires. Il est publié d'abord dans la collection Hetzel puis dans la Bibliothèque d’Éducation et de Récréation[6].
De nombreuses dates de publication ont été avancées, la plus courante étant le 31 janvier 1863 reprise sur une liste établie par la maison Hetzel après la mort de Jules Verne, en 1905. Pourtant, il est annoncé dans la presse dès le 15 janvier 1863, Le Figaro avertissant ses lecteurs de sa parution le jour même et la date est corroborée par la Bibliographie de la France du 17 janvier. Le 22 janvier, Le Figaro publie une nouvelle annonce déclarant que le roman venait de paraître. Il a donc été publié le 15 janvier 1863, date non anodine pour l'éditeur puisqu'il fêtait ce jour-là ses 49 ans, puis fut distribué le 22[7].
Le sous-titre est Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais rédigé sur les notes du docteur Fergusson avant de devenir à partir du troisième tirage, Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais rédigé d'après les notes du docteur Fergusson[8].
Quatre imprimeurs vont se succéder : Poupart-Daryl (1863-1865 et 1867-1871)), Charles Noblet (1865-1866), Lahure (1872-vers 1880) et Gautier-Villars (v.1880-1914).
L'ouvrage sera non illustré jusqu'en 1892 (62e édition) avant de l'être par Édouard Riou et Henri de Montaut, dont cinq planches (un frontispice et quatre hors pagination). Il comprend ainsi 83 éditions, ce qui le place à la deuxième place des tirages après Le Tour du monde en quatre-vingts jours (151 éditions) jusqu'au rachat d'Hetzel par Hachette en 1914[9].
Aucun manuscrit du roman n'a été retrouvé. Il ne subsiste que deux fragments[10].
Accueil critique
La première critique à paraître sur le roman est un article de la Revue des deux Mondes du 1er février 1863 édité sur le verso de la couverture. Le texte est signé de deux initiales, L.M. Il s'agit en fait d'une adaptation du « prière d'insérer » d'Hetzel. Le 8 février 1863, date de l'anniversaire de Jules Verne, paraît un second article dans Le Figaro qui ressemble aussi à une annonce publicitaire de l'éditeur[11]. Suit un article du même type dans le Journal des Débats[12].
Le 18 février, Henri Lacroix rédige pour Le Moniteur universel[13] le premier véritable article critique. Il écrit : « Pourtant, je regrette que le docteur et ses compagnons Dick et Joe, deux originaux que je vous recommande, soient si pressés de dégonfler leur aérostat. Ils ont vu, certes, bien des choses mais ils ont aussi laissé derrière eux bien des observations bonnes à relater. Cette réserve faite, je n'ai plus qu'à louer les Cinq semaines en ballon. Le livre est amusant et écrit avec esprit ».
D'autres éloges, signées Émile Cantrel, paraissent dans La Presse le 3 mars 1862 : « Ce livre restera comme le plus curieux et le plus utile des voyages imaginaires, comme un de ces rares livres qui méritent la fortune des Robinson et des Gulliver, et qui ont sur eux l'avantage de ne pas sortir un instant de la réalité, de s'appuyer, dans la fantaisie et dans l'invention, sur les faits, sur la science positive et irrécusable ».
Dans L'Opinion nationale[14] du 11 avril 1863, Jean Macé, proche de Hetzel, écrit un long article sur le roman, tout à la louange de celui-ci : « De ce mélange d'érudition patiente et de spirituelle imagination est sorti un des livres les plus amusants et les plus instructifs en même temps qui puissent charmer les loisirs d'une soirée d'hiver » et plus loin il signale qu' « Il manque une chose au livre de M. Jules Verne : une carte où l'on puisse suivre du doigt le sillon tracé dans les airs par son fantastique ballon .... L'homme qui a fait le livre était certainement en état de faire la carte, et c'est une galanterie qu'il devrait bien aux nombreux lecteurs qu'on peut lui prédire ».
Le 24 avril dans Le Petit Journal, qui a été fondé le 1er avril, Ernest Gervais publie le 1er article indépendant, ici aussi tout autant louangeur que les précédents.
Enfin, coïncidence symbolique, le 15 juin 1863, un petit article sur le roman paraît dans le Musée des familles[15], précédé de l'annonce du décès subit de Pitre-Chevalier, directeur du Musée lorsque Jules Verne y publiait ses premières nouvelles Les Premiers navires de la marine mexicaine, Un Voyage en ballon, Martin Paz, Un hivernage dans les glaces ou encore Maître Zacharius ou l'horloger qui avait perdu son âme.
Thèmes abordés dans le roman
- L’exploration de territoires inconnus (contexte de l’époque de la rédaction du roman). Verne expose les connaissances de l'époque en matière de géographie de l'Afrique.
- Étude ethnologique, faite par des Européens, des populations africaines
- Discours sur les races et les ethnies
- Le grand rôle de l’évangélisation (dans le personnage du missionnaire lazariste)
- L’aérostation, domaine où Jules Verne fait œuvre d'anticipation. L’invitation au voyage spatial qu’éprouvent les protagonistes de ce roman (ils anticipent de ce fait sur le périple cosmique de De la Terre à la Lune)
- Les grands phénomènes atmosphériques (comme l’épisode de la montée d'un orage tropical)
- La phobie vernienne de l’or (également perceptible dans Le Volcan d'or)
- Critique de l’esclavage (dans l’évocation de Zanzibar et de son « grand marché des esclaves »)
- Critique de la peine de mort (Fergusson considérant que la peine de mort appliquée par les "sauvages" est plus cruelle, mais tout aussi barbare que la pendaison dans son propre pays).
Le secret de l'aérostat du Dr Fergusson
Le ballon qui emmène les héros du roman au dessus des contrées inexplorées de l'Afrique combine les techniques du ballon à gaz et de la Montgolfière. Dans le premier, l'enceinte du ballon est fermée et gonflée d'un gaz plus léger que l'air (ici, l'hydrogène) ; la montée ou la descente se commandent respectivement par le lâcher de lest embarqué au départ de l'engin,ou par l'ouverture d'une valve laissant échapper un peu de gaz. Dans le second cas, le ballon est ouvert vers la bas et empli d'air que l'on chauffe ou laisse refroidir selon qu'on veut monter ou descendre.
Le ballon du Dr Fergusson est un ballon à hydrogène que l'on va pouvoir manœuvrer en chauffant plus ou moins le gaz contenu dans l'enveloppe : à la différence du système avec valve, on ne doit - en théorie - perdre aucun gaz, ce qui va permettre les plus longs parcours aériens. Le chauffage du gaz est assuré par un système de tuyaux pénétrant dans le ballon et parcourus par un gaz qui passe dans un échangeur thermique chauffé par un chalumeau hydrogène/oxygène dont le débit est réglable. Ces deux gaz sont produits par l'électrolyse de l'eau grâce à l'électricité produite par une pile Bunsen. Cela, c'est la théorie, et il y a au moins un cas ou le système est réputé avoir fonctionné, sans que l'ensemble explose : le voyage de cinq semaines en ballon décrit par Jules Verne ...
La représentation du sauvage africain dans l'œuvre
Dans ce premier roman de Jules Verne le sauvage est décrit par le regard des trois explorateurs. Nous pouvons tout d'abord dresser un champ lexical autour de la représentation de ce sauvage africain. Le mot "race" apparaît trois fois. Le mot "nègre" est employé 27 fois. Le mot sauvage pour désigner en tant que tel les Africains est utilisé 30 fois. Dans le roman le véritable but n'est pas vraiment d'explorer l'Afrique mais de la parcourir le plus rapidement possible avec le ballon. Cinq semaines équivalent à 35 jours ce qui est assez court. Pour ce qui est de l'exploration du continent elle n'est pas primordiale. Les explorateurs descendent peu sur la terre ferme, ils n'y vont que pour se réapprovisionner en eau ou nourriture. Dans leur optique monter avec le ballon est une progression dans le voyage, et descendre au contraire les fait s'arrêter. C'est donc un paradoxe pour ces explorateurs. Le sujet de cette exploration est plus un survol de la nature par les hommes, nature qui défile sous leurs pieds. Pour Fergusson, l'Afrique est une terre inhospitalière. Les dangers sont en bas et non en haut. Dans le roman la norme de la civilisation est incarnée dans ces trois anglais. La civilisation la plus avancée de l'Afrique décrite par Jules Verne est celle de l'Ugogo "où la civilisation est peut être la moins arriérée, on y vend plus rarement les membres de sa famille ; mais bêtes et gens tous vivent ensemble" dans le chapitre 14. Verne décrit une civilisation à l'opposé des trois anglais.
L'animalisation du sauvage
A plusieurs reprise le sauvage est décris par un procédé d'animalisation. Ils sont souvent décris par des comportement les rapprochant de singes. Relisons divers extrait pour comprendre cette animalisation.
"Les nègres continuait à manifester leur colère par des cris, des grimaçes et des contorsions" chapitre 11. " une trentaine d'individu se pressaient en gesticulant, en hurlant, en gambadant au pied du sycomore"
Les explorateurs sont poursuivis par ce qu'ils pensent être des africains mais " juste après ils se rendent compte que ce ne sont que des singes" Le chasseur commente "de loin la différence n'est pas grande mon cher Samuel" ce dernier ajoute "ni même de près".
"leur chants sans mélodies appréciable" chapitre 11. Les chants sont difficilement inaudibles pour trois explorateurs
"la foule de nègres unissait ses hurlements aux cris de la cour, répétant se gesticulations à la manière des singes" chapitre 30
"se coulant sur les branches comme des reptiles, ils se trahissaient alors par les émantions de leurs corps frottés d'une graisse infecte"
"tout ces africains imitateurs comme des singes" chapitre 15
Dans l’œuvre le lecteur peut avoir une vision clair de l'image que donne Jules Verne du sauvage africain. Ils sont effectivement plus proches d'animaux que d'homme. Il est intéressant d'observer comme Jules Verne déshumanise le sauvage africain, leur compagnie ne semble pas être de tout repos pour les trois explorateurs.
Le sauvage un cannibale
L’anthropophagie est un thème récurrent dans les Voyages extraordinaires. Elle apparaît dans dix romans de Jules Verne. Même procédé que pour l'animalisation du sauvage, nous allons citer quelques passages qui illustrent le sauvage cannibale dans le roman.
"un sycomore gigantesque dont le tronc disparaît en entier sous un amas d'ossements humains"
sur ce sycomore les explorateurs pensent voir des fleurs mais elles sont en réalité des "têtes fraîchement coupées suspendue à poignards fixé dans l'écorce"

Au chapitre 20 les trois anglais assistent de leur nacelle à un féroce combat entre deux tribus. Un combat où l'usage semble être un atout précieux pour les africains.
"un chef rejeta loin de lui sa sagaie rouge de sang, se précipité sur un blessé dont il trancha le bras d'un seul coup, et le portant à sa bouche, il y mordit à pleine dents"
"dès qu'un ennemi gisait sur le sol son adversaire se hâtait de lui couper la tête ; les femmes mêlées à cette cohue ramassaient les têtes sanglantes et les empalaient à chaque extrémité du champ de bataille ; souvent elles se battaient pour conquérir ce hideux trophée" Chapitre 20
"la tribu victorieuse se précipitant sur les morts et les blessés se disputer cette chair encore chaude et s'en repaître avidement"
Le cannibalisme dans le roman se retrouve même jusque dans le nom donné au tribus. En effet une des tribus rencontrés par les anglais se nomme "Nyam-Nyam" pour Fergusson c’est une "dénomination générale, une onomatopée, il reproduit le bruit de la mastication". Le nom de tribus à donc pour simple origine le bruit que font les sauvages quand ils mangent. Ce qui est assez réducteur de la part d'un scientifique.
Un autre point à aborder dans le cannibalisme du roman. Pour Fergusson ce qui le différencie comme un être humain à part entière des sauvages est le fait que lui mange de la viande cuite mais uniquement d'origine animal. Manger de la viande d'origine humaine revient pour lui à être un sauvage.
Le cannibalisme est aussi présent chez les trois explorateurs mais sous une forme moins démonstrative. Le personnage de Joe préfère être manger par son maître Fergusson plutôt que par les cannibales "si jamais je dois être mangé dans un moment de disette je veux que ça soit à votre profit et à celui de mon maître ! Mais nourrir ces moricauds, fi donc ! j'en mourrais de honte" Joe donc autorise son corps à être mangé par son maître mais si jamais les sauvages se risquaient à le goûter il vivrais cela comme un déshonneur. C'est à se demander qui est le plus humain !
Des êtres inférieurs
Dans un dernier point nous pouvons aborder une dernière représentation des sauvages. Ils sont vus comme des êtres peu intelligents. Partout où le ballon passe les africains le prennent pour une manifestation divine. Notamment chez les Ugogo qui pensent que le Victoria est la Lune elle même qui est descendu sur Terre et que les trois explorateurs sont des sorciers envoyés pour guérir le chef malade.
Dans le chapitre 20 "je m'en vais leur jeter une bouteille vide avec votre permission mon maître ; si elle arrive seine et sauve, ils l'adoreront ; si elle se casse ils se feront des talismans avec les morceaux !" chapitre 20. Les plus cinéphiles trouveront ici une futur référence au film Les dieux sont tombés sur la tête
Toutefois il est important de remettre ces représentations dans le contexte d'écriture. En 1863 l'Afrique est encore un continent très peu exploré. L'homme connait les côtes mais n'a pas encore exploré le continent dans sa totalité. Ce qui peut expliqué ces descriptions d'un africain complétement sauvage, animal et cannibale.
Citation
- « D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit ! A force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles ! Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à trois milliards d'atmosphères fera sauter notre globe ! »[16].
Adaptations
Le roman est adapté au cinéma à plusieurs reprises. En 1961, le réalisateur américain Nathan Juran réalise Flight of the Lost Balloon, directement adapté du roman. Mais pendant la production du film, un autre réalisateur américain, Irwin Allen, s'est également lancé dans l'adaptation du roman au cinéma : sous la pression d'Allen et de la 20th Century Fox, Nathan Juran efface toute référence à Jules Verne et au roman dans le film et le générique ; seul reste le nom du ballon, le Victoria. Peu après la sortie du film de Juran, en 1962, sort la deuxième adaptation du film, Cinq semaines en ballon (Five Weeks in a Balloon ) d'Irwin Allen, une libre adaptation du roman. En 1966, le réalisateur roumain Olymp Varasteanu réalise Cinci saptamîni în balon. En 1975, le réalisateur mexicain René Cardona Jr réalise Viaje Fantástico en Globo, avec Hugo Stiglitz.
Bibliographie
- Marie Thébaud-Sorger. L'aérostat au service de l'espace temps de Jules Verne dans son premier roman, "Cinq semaines en ballon". Revue Jules Verne 25, La science en drame, Centre international Jules Verne 2007, p. 51-58.
- Olivier Dumas, Observations nouvelles sur le rare premier cartonnage de Cinq semaines en ballon , Bulletin de la Société Jules Verne n° 172, 2009, p.49-56
- Les Bulletins de la Société Jules Verne n°183 (août 2013) et 184 (décembre 2013) sont entièrement consacrés à l'étude du roman.

- Seillan, Jean-Marie, Aux sources du roman colonial, 1863-1914 L'Afrique à la fin du XIXe siècle, Paris, Karthala, Lettres du Sud, 2006, 509 p.
- Durand Jean-François et Naumann Michel, Nudité, sauvagerie, fantasmes coloniaux dans les littératures coloniales, Paris, Editions Kailash, 2004, 198 p.
- Dusseau Joëlle, Jules Verne, Paris, Perrin, 2005, 500p.
- Lestringant Frank, Le Cannibale. Grandeur et décadence, Paris, Perrin, coll "Histoire et décadence", 1994, 320 p.
Notes et références
- Volker Dehs dans son étude La Bi(bli)ographie de Cinq semaines en ballon'' prouve que la date exacte de publication est en vérité le 15 janvier 1863 (Bulletin de la Société Jules-Verne n°183, avril 2013, p.7).
- Bibliographie analytique de toutes les œuvres de Jules Verne, par Piero Gondolo della Riva. Tome I. Pages 6-7. Société Jules-Verne. 1977.
- Volker Dehs, La Bi(bli)ographie de Cinq semaines en ballon'', Bulletin de la Société Jules-Verne n°183, avril 2013, p.4
- Volker Dehs, Quand Jules Verne rencontre Hetzel, Revue Jules Verne n°37, 2013
- Dehs, La Bi(bli)ographie..., p.5
- Feuilleton du journal général de l'imprimerie et de la librairie n°23, 6 juin 1863, p.388
- Volker Dehs, ibid, p.7
- Dehs, op.cit, p.12
- Dehs, p.12
- Fragments publiés dans le Bulletin de la Société Jules Verne n°183, avril 2013, p.20-30
- Le Figaro n°833, p.7 dans la rubrique Petite Gazette de Paul Dollingen
- 12 février, p.2
- n°48, p.248-249
- n°99, p.1
- no 9, p.18
- Cinq semaines en ballon, chapitre XVI
